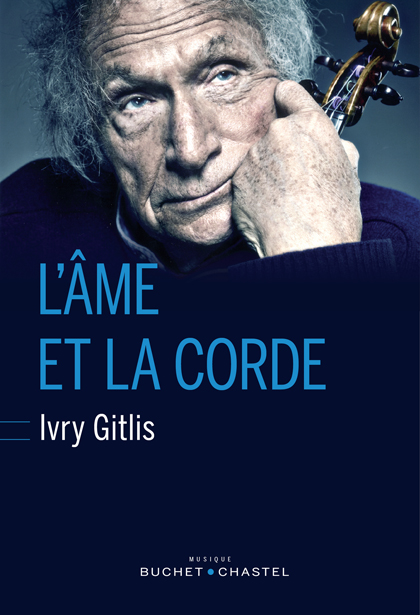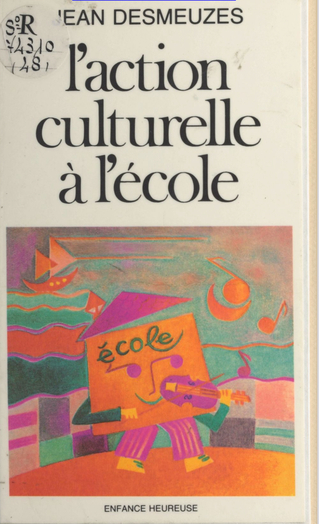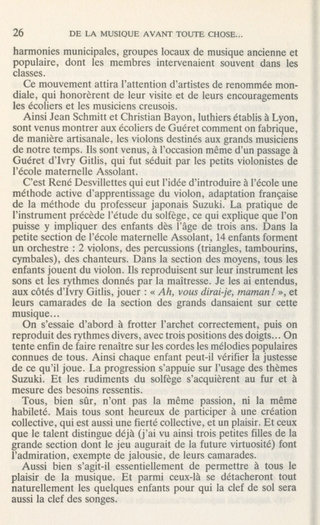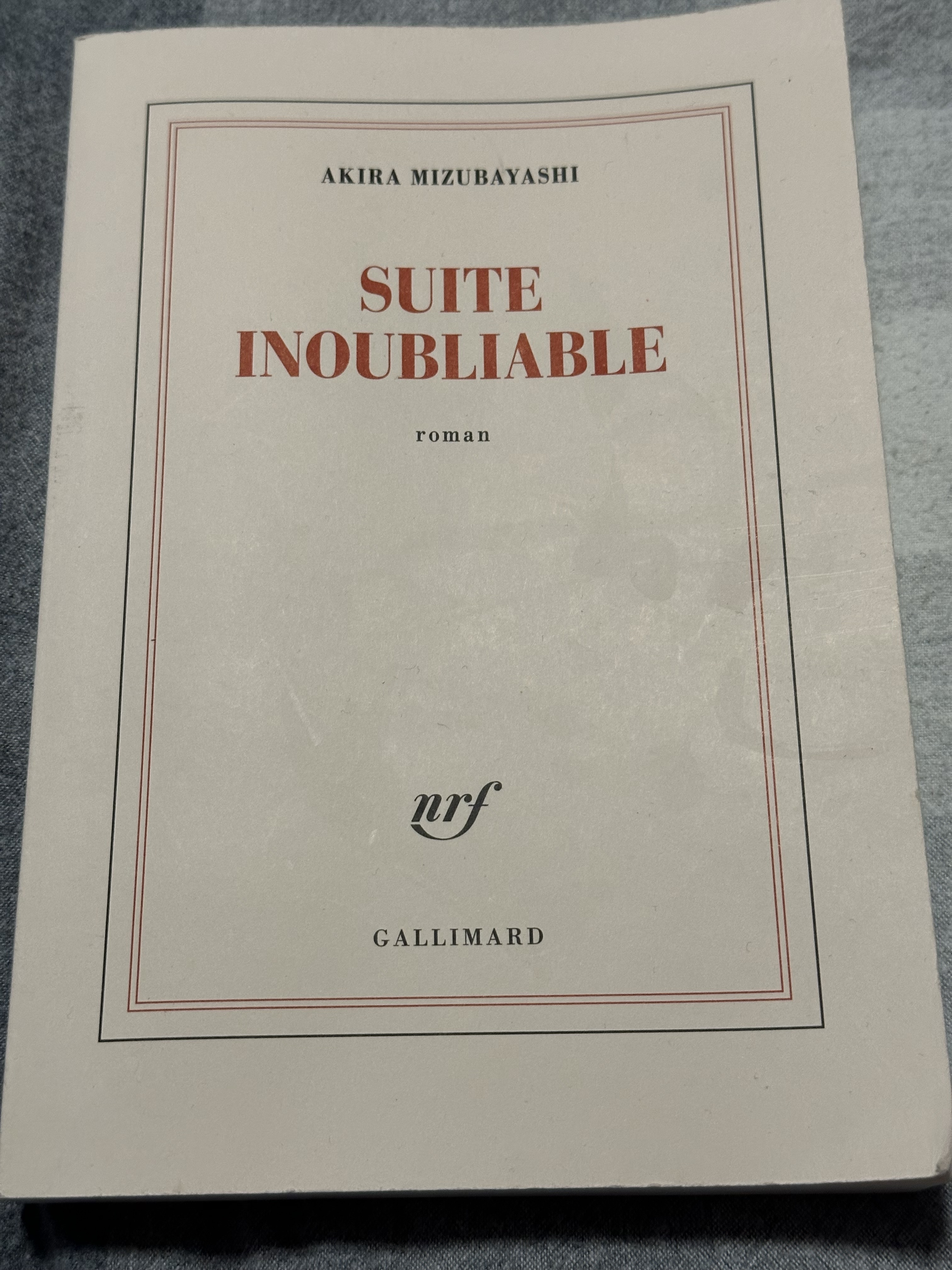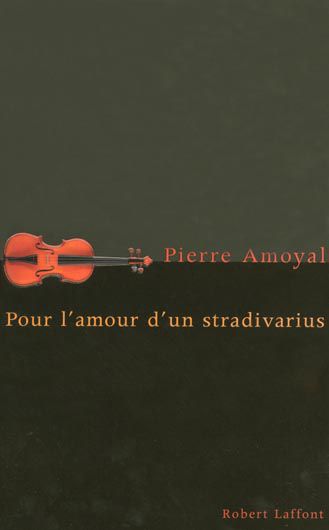Re: Liste de livres sur le violon
Publié : dim. 10 sept. 2023 17:45
Merci Salome pour ce conseil !
Puisqu'on est dans la sociologie de la musique, je vous signale ce livre : L'orchestre dans tous ses éclats. Ethnographie des formations symphoniques, Bernard Lehmann, éditions La Découverte, 2002.
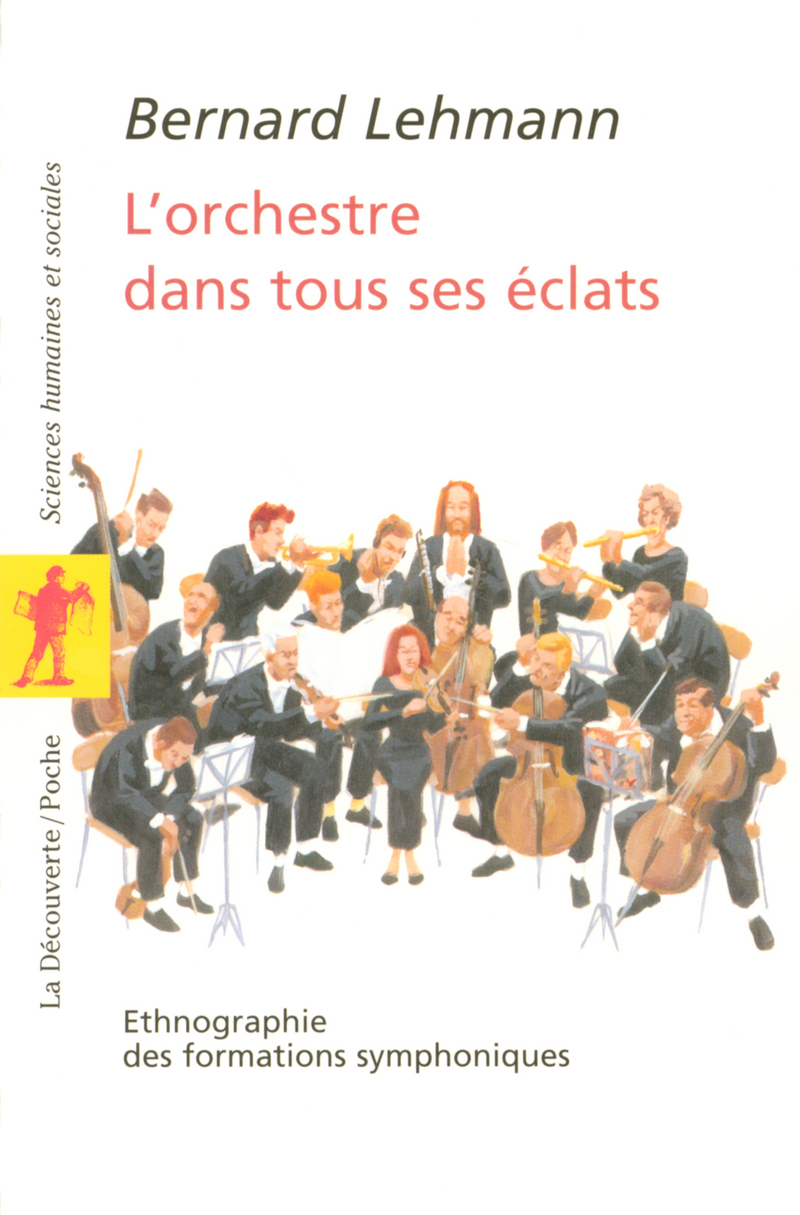
Il n'est plus édité et n'existe aujourd'hui que d'occasion, mais vous pourrez certainement le trouver en bibliothèque si vous souhaitez le lire. Plusieurs librairies proposent également de le commander.
Résumé de l'éditeur : Au terme d'un travail d'enquête mené durant près de cinq années au sein des principaux orchestres parisiens, Bernard Lehmann a entrepris, dans ce livre, de mettre au jour les hiérarchies et lignes de fracture invisibles, multiples, tant musicales que sociales qui traversent les formations symphoniques. Il met en évidence le lien entre le prestige symbolique d'une famille instrumentale et le recrutement de ses praticiens : aux cordes fréquemment originaires de milieux dominants, s'opposent les cuivres issus des milieux plus défavorisés. Mais, paradoxalement, les orchestres, dans leur fonctionnement interne, produisent aussi des classifications qui contredisent les hiérarchies sociales : les moins favorisés socialement se trouvent détenir les postes de soliste les plus enviés et les salaires les plus élevés, quand les plus dotés sont souvent renvoyés à l'anonymat des positions de tuttistes. À travers de nombreux portraits de musiciens, l'auteur montre comment ces hommes et femmes vivent au quotidien leur métier de musicien d'orchestre, relisent leur passé, parlent d'eux, acceptent ou non de jouer le jeu du chef lors des répétitions. En somme, à rebours de ce que laisse entendre le moment du concert et de l'interprétation, Bernard Lehmann affirme sans détour : le musical, c'est aussi du social.
https://www.editionsladecouverte.fr/l_o ... 2707146106
Table des matières :
Introduction
Question de méthode
Les formations étudiées
1. Structure et morphologie de l'orchestre
Les vents en quête de légitimité
Comment disposer les musiciens ?
Morphologie de l'orchestre
2. Les hiérarchies sociales de l'orchestre
Les propriétés sociales des musiciens
Les premiers pas et le choix de l'instrument
La rationalité professionnelle des héritiers
La musique en famille
Les aléas de l'offre instrumentale en milieux populaires
3. Hiérarchies statutaires de l'orchestre et moments clés de la carrière
Les héritiers sur les rails
Les déclassés
Les instrumentistes promus
4. Trajectoires d'exception de deux autodidactes
Jérôme : entre le jazz et le classique
Jean ou la vie comme un conte oriental
5. La terre promise : les usages sociaux des activités hors de l'orchestre
Le Conservatoire de Paris comme lieu de constitution de relations professionnelles
Les déclassés et le quatuor
Le sens pratique des héritiers
Les promus : entre le jazz et la java
6. Points de vue sur l'orchestre
L'orchestre vu des cordes
L'orchestre vu des vents
7. La répétition : construction sociale de l'interprétation
L'organisation des répétitions
Du pouvoir absolu des chefs à la réalité des répétitions
Les musiciens entre eux
8. L'orchestre en représentation : l'unité recomposée ?
L'orchestre poreux
La fosse de l'Opéra comme lieu de profanation des rituels
Les programmes annuels de concerts
L'Orchestre télévisé
Conclusion
Commentaire personnel :
Grâce à une enquête par observation de répétitions et de concerts et par entretiens avec les musiciens, l'auteur met en évidence les structures sociales internes d'un orchestre. Il montre la différence nette entre les instrumentistes à cordes, originaires des classes les plus favorisées, aux vents dont l'origine est plus souvent populaire : paradoxalement peut-être, au sein de l'orchestre, les cordes sont pour beaucoup tuttistes et peu mises en valeur, tandis que les vents sont plus souvent solistes. Des différences de goûts et de pratiques culturelles existent aussi, l'exemple typique est celui des cordes qui lisent Le Monde pendant que les vents lisent L'Equipe.
Ces distinctions peuvent paraître grossières, mais l'auteur en fait une analyse plus fine : par exemple en distinguant les familles des bois et des cuivres parmi les vents, les basses et les violons chez les cordes... Il revient aussi sur les différences entre les "héritiers", ceux dont les parents étaient eux-mêmes musiciens professionnels, et les autres : en effet, les "héritiers" acceptent sans broncher la rigueur de l'apprentissage musical et l'anonymat des rangs de l'orchestre, de même que certains musiciens d'origine populaire, tandis que ceux d'origine favorisée peuvent vivre cet anonymat comme un déclassement.
Il y a aussi une partie sur l'apprentissage des instruments à cordes et l'approche "mécaniste" déjà évoquée dans ce fil, par laquelle la majorité des cordes sont passées et dont ils gardent les traces dans leur approche de l'instrument. J'ai particulièrement savouré le fait que l'auteur cite Dominique Hoppenot à ce sujet. Il parle aussi des conservatoires où les futurs professionnels travaillent principalement des pièces de musique de chambre (sonates, quatuors...) ou des solos de concerto, où leur jeu personnel est mis en valeur, ce qui crée une frustration à l'arrivée dans l'orchestre où il faut au contraire créer un "son de pupitre" qui ne montre pas l'individualité de l'artiste.
C'est souvent très bourdieusien, l'accent est mis sur les hiérarchies et la domination, tant dans l'origine sociale des instrumentistes que sur leurs positions au sein de l'orchestre. On est en 2002, et on sent qu'à cette époque-là les idées de Bourdieu prennent toute la place dans la recherche en sociologie. En faisant la même enquête aujourd'hui, on s'intéresserait peut-être plus au sens donné par les musiciens à leur activité professionnelle, leur présentation d'eux-mêmes vis-à-vis de leur entourage, la manière dont ils intériorisent et expliquent les divisions de l'orchestre...
Le livre est structuré de manière intéressante : les chapitres sont chronologiques et vont du choix de l'instrument à la professionnalisation et l'entrée à l'orchestre, puis aux répétitions et concerts. Personnellement j'ai trouvé les premiers chapitres plutôt barbants (bourrés d'évidences et de redites), la qualité de l'analyse augmente au fur et à mesure des chapitres, à l'exception du dernier qui selon moi part dans tous les sens et surinterprète sociologiquement des choses qui ont un sens musical (mais l'auteur dirait peut-être que l'orchestre met ainsi en place un système d'autodéfense face à une analyse sociologique qui remet en question l'ordre établi ). Mention spéciale pour le chapitre 7 sur la construction de l'interprétation et le travail d'ajustement entre l'orchestre et le chef, j'aurais presque voulu qu'il soit plus long : l'auteur développe trois exemples de répétitions qu'il présente comme des idéaux-types, j'aurais voulu d'autres exemples pour montrer la diversité de ce que chaque idéal-type peut recouvrir.
). Mention spéciale pour le chapitre 7 sur la construction de l'interprétation et le travail d'ajustement entre l'orchestre et le chef, j'aurais presque voulu qu'il soit plus long : l'auteur développe trois exemples de répétitions qu'il présente comme des idéaux-types, j'aurais voulu d'autres exemples pour montrer la diversité de ce que chaque idéal-type peut recouvrir.
De manière globale, je dirais que c'est une lecture qui en vaut la peine. Le livre se lit facilement, peut-être un peu plus lorsqu'on a des notions de sociologie, mais les nombreux témoignages et exemples permettent de rentrer facilement dans l'analyse de l'auteur. Par contre, si vous êtes allergique aux analyses de type Bourdieu, fuyez, ce livre représente un danger pour votre santé
Je précise aussi qu'il faut s'attendre à être parfois "dérangé" par les analyses, mis mal à l'aise... C'est normal quand on lit un livre de socio sur notre propre univers (essayez avec un livre sur votre métier ou un autre de vos loisirs, vous verrez !), surtout avec l'analyse de la domination au sein de l'orchestre que développe l'auteur, vu qu'en tant que "cordes dominantes", on a l'impression de passer pour les grands méchants de l'histoire... Il faut y être prêt, se dire qu'on n'a pas choisi d'être "dominant" plus que d'autres ont choisi d'être "dominés" (je mets des guillemets car les frontières de cette catégorisation sont plus floues que ça, il faut lire le livre pour comprendre). Prendre un peu de recul sur les analyses de l'auteur, boire une tisane, lire un peu de Goffman, et puis ça ira
Puisqu'on est dans la sociologie de la musique, je vous signale ce livre : L'orchestre dans tous ses éclats. Ethnographie des formations symphoniques, Bernard Lehmann, éditions La Découverte, 2002.
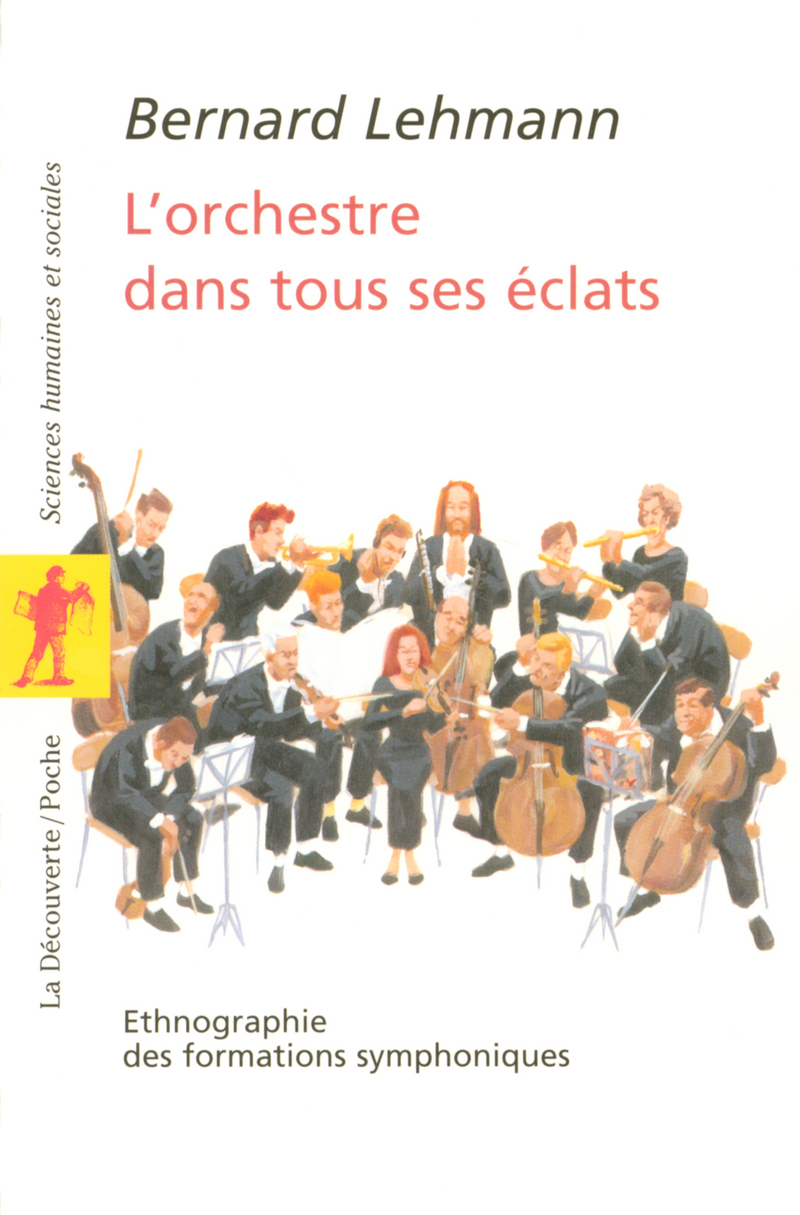
Il n'est plus édité et n'existe aujourd'hui que d'occasion, mais vous pourrez certainement le trouver en bibliothèque si vous souhaitez le lire. Plusieurs librairies proposent également de le commander.
Résumé de l'éditeur : Au terme d'un travail d'enquête mené durant près de cinq années au sein des principaux orchestres parisiens, Bernard Lehmann a entrepris, dans ce livre, de mettre au jour les hiérarchies et lignes de fracture invisibles, multiples, tant musicales que sociales qui traversent les formations symphoniques. Il met en évidence le lien entre le prestige symbolique d'une famille instrumentale et le recrutement de ses praticiens : aux cordes fréquemment originaires de milieux dominants, s'opposent les cuivres issus des milieux plus défavorisés. Mais, paradoxalement, les orchestres, dans leur fonctionnement interne, produisent aussi des classifications qui contredisent les hiérarchies sociales : les moins favorisés socialement se trouvent détenir les postes de soliste les plus enviés et les salaires les plus élevés, quand les plus dotés sont souvent renvoyés à l'anonymat des positions de tuttistes. À travers de nombreux portraits de musiciens, l'auteur montre comment ces hommes et femmes vivent au quotidien leur métier de musicien d'orchestre, relisent leur passé, parlent d'eux, acceptent ou non de jouer le jeu du chef lors des répétitions. En somme, à rebours de ce que laisse entendre le moment du concert et de l'interprétation, Bernard Lehmann affirme sans détour : le musical, c'est aussi du social.
https://www.editionsladecouverte.fr/l_o ... 2707146106
Table des matières :
Introduction
Question de méthode
Les formations étudiées
1. Structure et morphologie de l'orchestre
Les vents en quête de légitimité
Comment disposer les musiciens ?
Morphologie de l'orchestre
2. Les hiérarchies sociales de l'orchestre
Les propriétés sociales des musiciens
Les premiers pas et le choix de l'instrument
La rationalité professionnelle des héritiers
La musique en famille
Les aléas de l'offre instrumentale en milieux populaires
3. Hiérarchies statutaires de l'orchestre et moments clés de la carrière
Les héritiers sur les rails
Les déclassés
Les instrumentistes promus
4. Trajectoires d'exception de deux autodidactes
Jérôme : entre le jazz et le classique
Jean ou la vie comme un conte oriental
5. La terre promise : les usages sociaux des activités hors de l'orchestre
Le Conservatoire de Paris comme lieu de constitution de relations professionnelles
Les déclassés et le quatuor
Le sens pratique des héritiers
Les promus : entre le jazz et la java
6. Points de vue sur l'orchestre
L'orchestre vu des cordes
L'orchestre vu des vents
7. La répétition : construction sociale de l'interprétation
L'organisation des répétitions
Du pouvoir absolu des chefs à la réalité des répétitions
Les musiciens entre eux
8. L'orchestre en représentation : l'unité recomposée ?
L'orchestre poreux
La fosse de l'Opéra comme lieu de profanation des rituels
Les programmes annuels de concerts
L'Orchestre télévisé
Conclusion
Commentaire personnel :
Grâce à une enquête par observation de répétitions et de concerts et par entretiens avec les musiciens, l'auteur met en évidence les structures sociales internes d'un orchestre. Il montre la différence nette entre les instrumentistes à cordes, originaires des classes les plus favorisées, aux vents dont l'origine est plus souvent populaire : paradoxalement peut-être, au sein de l'orchestre, les cordes sont pour beaucoup tuttistes et peu mises en valeur, tandis que les vents sont plus souvent solistes. Des différences de goûts et de pratiques culturelles existent aussi, l'exemple typique est celui des cordes qui lisent Le Monde pendant que les vents lisent L'Equipe.
Ces distinctions peuvent paraître grossières, mais l'auteur en fait une analyse plus fine : par exemple en distinguant les familles des bois et des cuivres parmi les vents, les basses et les violons chez les cordes... Il revient aussi sur les différences entre les "héritiers", ceux dont les parents étaient eux-mêmes musiciens professionnels, et les autres : en effet, les "héritiers" acceptent sans broncher la rigueur de l'apprentissage musical et l'anonymat des rangs de l'orchestre, de même que certains musiciens d'origine populaire, tandis que ceux d'origine favorisée peuvent vivre cet anonymat comme un déclassement.
Il y a aussi une partie sur l'apprentissage des instruments à cordes et l'approche "mécaniste" déjà évoquée dans ce fil, par laquelle la majorité des cordes sont passées et dont ils gardent les traces dans leur approche de l'instrument. J'ai particulièrement savouré le fait que l'auteur cite Dominique Hoppenot à ce sujet. Il parle aussi des conservatoires où les futurs professionnels travaillent principalement des pièces de musique de chambre (sonates, quatuors...) ou des solos de concerto, où leur jeu personnel est mis en valeur, ce qui crée une frustration à l'arrivée dans l'orchestre où il faut au contraire créer un "son de pupitre" qui ne montre pas l'individualité de l'artiste.
C'est souvent très bourdieusien, l'accent est mis sur les hiérarchies et la domination, tant dans l'origine sociale des instrumentistes que sur leurs positions au sein de l'orchestre. On est en 2002, et on sent qu'à cette époque-là les idées de Bourdieu prennent toute la place dans la recherche en sociologie. En faisant la même enquête aujourd'hui, on s'intéresserait peut-être plus au sens donné par les musiciens à leur activité professionnelle, leur présentation d'eux-mêmes vis-à-vis de leur entourage, la manière dont ils intériorisent et expliquent les divisions de l'orchestre...
Le livre est structuré de manière intéressante : les chapitres sont chronologiques et vont du choix de l'instrument à la professionnalisation et l'entrée à l'orchestre, puis aux répétitions et concerts. Personnellement j'ai trouvé les premiers chapitres plutôt barbants (bourrés d'évidences et de redites), la qualité de l'analyse augmente au fur et à mesure des chapitres, à l'exception du dernier qui selon moi part dans tous les sens et surinterprète sociologiquement des choses qui ont un sens musical (mais l'auteur dirait peut-être que l'orchestre met ainsi en place un système d'autodéfense face à une analyse sociologique qui remet en question l'ordre établi
De manière globale, je dirais que c'est une lecture qui en vaut la peine. Le livre se lit facilement, peut-être un peu plus lorsqu'on a des notions de sociologie, mais les nombreux témoignages et exemples permettent de rentrer facilement dans l'analyse de l'auteur. Par contre, si vous êtes allergique aux analyses de type Bourdieu, fuyez, ce livre représente un danger pour votre santé
Je précise aussi qu'il faut s'attendre à être parfois "dérangé" par les analyses, mis mal à l'aise... C'est normal quand on lit un livre de socio sur notre propre univers (essayez avec un livre sur votre métier ou un autre de vos loisirs, vous verrez !), surtout avec l'analyse de la domination au sein de l'orchestre que développe l'auteur, vu qu'en tant que "cordes dominantes", on a l'impression de passer pour les grands méchants de l'histoire... Il faut y être prêt, se dire qu'on n'a pas choisi d'être "dominant" plus que d'autres ont choisi d'être "dominés" (je mets des guillemets car les frontières de cette catégorisation sont plus floues que ça, il faut lire le livre pour comprendre). Prendre un peu de recul sur les analyses de l'auteur, boire une tisane, lire un peu de Goffman, et puis ça ira